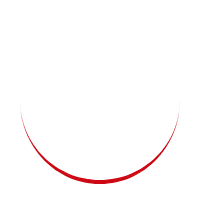Hier, 2007
Très tôt, Monika Schütze a su ce qu’elle voulait faire de sa vie : décrocher un travail à temps partiel qui la passionne, mais qui lui laisse assez de temps libre pour voyager. Si ce rêve s’est brisé, ce n’est pas par manque de volonté, c’est à cause de la maladie. A 41 ans, elle a maintenant compris qu’on ne prévoit pas tout dans la vie. Et même si aujourd’hui elle accepte son sort, vivre avec une maladie au pronostic incertain n’est pas simple tous les jours.

Il y a maintenant 18 ans, en voyage aux Etats-Unis et au Mexique, Monika Schütze est ravie, mais elle est en proie à quelques soucis : problèmes articulaires et diarrhées à répétition. Se pourrait-il que ce soit lié au mauvais lit et à la nourriture inhabituelle ? Ce n’est qu’une fois de retour en Suisse, alors que les symptômes persistent, qu’elle se décide à consulter un médecin : hépatite B, lui dit-on.
« Quand et comment aurais-je été contaminée ? ». Cette question la lancine ; elle ne comprend pas. Son corps non plus n’arrive pas à accepter le diagnostic. Comme les douleurs persistent, elle est redirigée vers un rhumatologue qui établit un autre diagnostic : la « connectivité mixte », une affection rhumatismale grave, proche du lupus érythémateux disséminé. Dans cette maladie inflammatoire, le système immunitaire s’attaque aux organes, provoquant des épaississements cutanés et des inflammations musculaires. « J’étais soulagée de pouvoir enfin mettre un nom sur ma maladie, mais je ne savais pas encore ce que cela signifiait pour mon avenir », se souvient Monika Schütze.
Des hauts et des bas

Après ce nouveau diagnostic, Monika Schütze entame un traitement à la cortisone ; elle se sent renaître. Mais le répit est de courte durée, et les années suivantes ressemblent à la lutte d’une embarcation de fortune prise dans une tempête. Il faut batailler de toutes parts : contre les troubles moteurs, les poussées de fièvre et les douleurs articulaires. Examens médicaux, séjours hospitaliers plus ou moins longs, tomographies, IRM et perfusions se succèdent.
« Le plus dur, c’est de ne rien pouvoir prévoir », reconnaît Monika, pensive. Avant la maladie, elle pouvait compter sur son corps ; aujourd’hui, elle ne sait même pas si elle arrivera sans problèmes jusqu’à la station de tram. Il est très difficile pour elle de vivre dans cette incertitude permanente. « Le groupe d’entraide des lupiques m’a beaucoup apporté et m’apporte toujours beaucoup », ajoute-t-elle. Au sein de ce groupe, elle a non seulement appris à parler de ses angoisses, mais elle a aussi pu approfondir sa connaissance de la connectivité mixte, ce qui est extrêmement important pour elle. « Mieux je comprends ma maladie, mieux j’arrive à vivre avec. L’incertitude me fait plus peur que les explications terribles que je lis parfois sur le sujet. »
Le travail, une réelle chance

Une bonne méthode pour surmonter les moments difficiles, c’est le travail. Monika est encore en mesure d’exercer une activité professionnelle, et, elle en a conscience, c’est une réelle chance. Après avoir été vendeuse, elle occupe un poste dans un bureau, mais son employeur fait faillite. « Pour moi, il était clair que je ne retrouverai jamais un travail avec ma maladie. » Elle s’adresse alors à la Ligue contre le rhumatisme, qui l’aide à déposer une demande de rente d’invalidité. Aujourd’hui, si elle vit grâce à une rente de l’AI, elle apprécie de travailler quelques heures dans une boutique de la bourse sociale pour l’emploi de Bâle, la « Soziale Stellenbörse ». Des handicapés y vendent des produits qu’ils fabriquent eux-mêmes. Monika Schütze encadre des personnes dont l’invalidité doit être évaluée dans le cadre d’une demande de rente. Quatre après-midi par semaine, elle leur confie des tâches qu’elle contrôle ensuite avant de leur donner un feedback. Travailler avec des personnes elles aussi limitées dans leurs activités professionnelles lui fait du bien. « Bien sûr, c’est un avantage d’être moi-même malade. Je comprends mieux les gens qui ont un handicap. »
Gérer ses forces
Il n’y a pas qu’au travail que Monika Schütze se sent mieux avec les handicapés. « Les gens qui n’ont aucun handicap physique ont du mal à me comprendre quand je suis épuisée. Beaucoup pensent qu’il faut me motiver et me stimuler – en fait, le mieux à faire, c’est de m’asseoir un peu. » Il est évident que les handicapés conçoivent autrement la question des limites physiques. C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles Monika Schütze se sent mieux au cours de gymnastique aquatique pour handicapés qu’à celui du club de natation. « Ici, beaucoup de personnes ont des handicaps physiques – je suis comme les autres, les regards ne sont pas tournés vers moi. »

Bien plus qu’un simple hobby, la gymnastique aquatique est l’une des multiples thérapies de Monika. La méthode Feldenkrais, la physiothérapie ou encore la musculation sont autant d’activités qui l’aident à entretenir la mobilité de son corps. Car c’est justement cela l’essentiel. S’il n’y a rien à faire pour empêcher les blocages, en étant plus mobile, il est plus facile d’en venir à bout. Vu sous cet angle, la mobilité, c’est une part d’indépendance. Une indépendance qui lui demande beaucoup d’efforts puisque chaque semaine, elle consacre cinq à six heures à ses séances de thérapies corporelles ainsi qu’à des rendez-vous médicaux. « Ces soins sont répartis sur quatre ou cinq matinées, certes, mais pour moi, c’est plutôt fatigant », doit-elle reconnaître. Et lorsque certaines personnes croient qu’elle enchaîne les grasses matinées, elle leur raconte point par point son programme hebdomadaire. « Les gens n’arrivent pas à comprendre à quoi ressemble mon quotidien avec la maladie. »
Aujourd’hui, 2025
« J’ai l’impression de vieillir un peu plus vite que les personnes en bonne santé. »

La première interview avec Monika Schütze remonte à 17 ans déjà. On parlait, à l’époque, d’une maladie sans pronostic pour l’avenir. La rencontre effectuée aujourd’hui pour le forumR n’en est que plus intéressante :
Comme c’est le cas pour toutes les personnes atteintes d’une maladie chronique, la maladie de Monika Schütze, 58 ans, a évolué. Au diagnostic de départ de lupus disséminé s’est ajouté ces dernières années un syndrome de Parkinson. Malgré diverses réadaptations, thérapies et médicaments, la mobilité de Monika Schütze s’est visiblement dégradée : elle basculait de plus en plus fortement sur le côté en marchant et il lui était impossible de se redresser complètement. Le lupus, toujours présent, est passé au second plan de la maladie Parkinson, comme l’explique Monika Schütze. Elle n’a aujourd’hui presque plus aucune poussée de lupus.
En 2013, une stimulation cérébrale profonde (SCP) lui a été recommandée en traitement de la maladie de Parkinson. Un an plus tard, la Bâloise s’est fait opérer et en a ressenti les bienfaits. Après quelques difficultés de démarrage, ses mouvements sont devenus plus fluides et contrôlés. Récemment, la SCP a été entièrement réajustée. L’ensemble est encore un peu instable, le côté gauche du corps et la main gauche posent encore problème. En outre, le phénomène des doigts à ressaut du lupus se combine à la rigidité et aux mouvements involontaires (dyskinésie) du syndrome de Parkinson.
Avec deux maladies, il est donc devenu encore plus compliqué d’émettre un pronostic pour l’avenir. Mais Monika Schütze ne se laisse pas abattre : en retraite anticipée, elle bricole toujours avec autant de passion et a appris à mieux répartir ses activités. Elle fait des pauses lorsqu’elle se sent fatiguée et demande de l’aide si nécessaire. Monika Schütze a accepté sa situation, tout comme le fait de vieillir un peu plus vite que les autres personnes.
La stimulation cérébrale profonde (SCP) consiste à implanter chirurgicalement dans le cerveau des électrodes qui émettent durablement des impulsions électriques et peuvent ainsi influer sur les symptômes, notamment ceux de la maladie de Parkinson.
Texte publié dans forumR 1/2025
Auteures : Astrid Steiner et Daria Rimann
Photos : Susanne Seiler