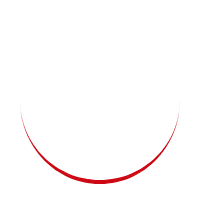Que sont les analgésiques (aussi appelés antalgiques ou antidouleurs), quelles sont les différences à connaître, et comment les emploie-t-on correctement en cas de rhumatismes ? Cet article fournit une vue d’ensemble des différentes substances et des conseils.
Les maladies rhumatismales s’accompagnent presque toujours de douleurs, qui sont souvent combattues avec des analgésiques. Lesquels sont pertinents et utiles contre les différentes douleurs rhumatismales ?
Comment agissent les analgésiques ?
Les analgésiques (ou antalgiques, antidouleurs) modifient, réduisent ou éliminent les signaux susceptibles de provoquer des douleurs. Ils font disparaître les symptômes, sans éliminer leur cause.
Qu’en est-il de l’emploi d’analgésiques en cas de rhumatismes ?
>> Pour traiter les maladies inflammatoires rhumatismales, les analgésiques dits « purs » ( sans effet anti-inflammatoire) ne sont prescrits qu’en complément aux anti-inflammatoires.
>> On emploie de préférence les analgésiques purs en cas d’arthrose douloureuse et, plus généralement, lorsque les composantes inflammatoires ne jouent qu’un rôle secondaire, voire en l’absence de signes d’inflammation. Vous en apprendrez davantage à ce sujet à la fin de cet article.
Quels sont les différents types d’analgésiques ?
On distingue en premier lieu les analgésiques opioïdes des analgésiques non opioïdes. L’échelle analgésique de l’OMS quant à elle divise ces substances en trois paliers. Ces deux classements certes sommaires aident à s’y retrouver parmi la multitude de produits sur le marché.
Les opioïdes
Le terme « opioïde » signifie « semblable à l’opium ». On obtient l’opium (du grec opos = jus) à partir du jus séché des capsules de graines immatures du pavot somnifère. On en tire aujourd’hui encore la morphine, un analgésique végétal autorisé en cas de douleurs intenses et très intenses. C’est pour ainsi dire l’origine des diverses substances à effet morphinique qui représentent aujourd’hui la majorité des opioïdes.
Globalement, toutes les substances qui se lient aux récepteurs opioïdes sont des opioïdes. On trouve ces récepteurs à la surface des cellules nerveuses et d’autres cellules réparties dans tout l’organisme. La plupart d’entre eux sont dans le cerveau et la moelle épinière ; l’intestin en compte également un grand nombre. Lorsque les opioïdes se lient à ces récepteurs, ils activent le système de modulation de la douleur du corps. Ce système inhibe alors la transmission des signaux de danger dans la moelle épinière et la perception de la douleur dans le cerveau. Aux effets analgésiques des opioïdes s’ajoutent d’autres effets morphiniques, comme la sédation et l’euphorie : ces médicaments calment et provoquent une intense sensation de bonheur (effet euphorisant).
Aujourd’hui, on nomme « opioïdes » toutes les substances qui agissent en interaction avec les récepteurs opioïdes. Ce terme n’est donc pas réservé aux opioïdes chimiques, ou opioïdes synthétiques. Il désigne aussi les substances purement végétales, tirées de l’opium, ainsi que l’endorphine (terme créé à partir d’« endogène », produit par l’organisme, et de « morphine »). Dans les situations d’urgence, il arrive que des personnes gravement blessées ne sentent pas immédiatement la douleur, car leur corps réagit en sécrétant de l’endorphine. L’endorphine a aussi un effet euphorisant, semblable aux opioïdes. Pour résumer, il existe donc trois types d’opioïdes :
l’opioïde endogène : l’endorphine ;
les opioïdes végétaux : la morphine et la codéine ;
les opioïdes synthétiques : le tramadol, la tilidine, le fentanyl, l’oxycodone, la buprénorphine, la péthidine, l’hydromorphone, etc.
Les opioïdes végétaux sont également appelés « opiacés ». La codéine (un opiacé) est en outre utilisée dans certains sirops contre la toux, car elle exerce un effet antitussif puissant.
Les analgésiques non opioïdes
Les analgésiques non opioïdes ne se lient pas aux récepteurs opioïdes ; leur mécanisme d’action est différent. Certains agissent probablement sur des récepteurs cérébraux, d’autres réduisent la production de prostaglandines. Les prostaglandines sont des substances messagères endogènes qui favorisent la transmission des stimuli lors des processus inflammatoires.
Le métamizole
Le métamizole est sans doute l’analgésique non opioïde le plus puissant. Il est également connu sous le nom de Novaminsulfon. Ce médicament soumis à ordonnance est très efficace mais controversé, car il est associé à un effet secondaire très rare : l’agranulocytose, une anomalie sanguine.
Le paracétamol
Les préparations à base de paracétamol comme Dafalgan®, Panadol®, Tylenol® ou Zolben® sont très répandues. Elles engendrent peu d’effets secondaires. Si elles sont pour la plupart en vente libre, cela ne veut pas dire qu’elles sont sans danger pour autant. En effet, une surdose de paracétamol peut rapidement endommager le foie. Si vous prenez un médicament contre les refroidissements à base de paracétamol tel que NeoCitran® ou Pretuval® en parallèle à du paracétamol, vous risquez de vite atteindre la dose quotidienne maximum de 4 g. Par précaution, ne prenez jamais un médicament contre la grippe en même temps qu’un analgésique.
La capsaïcine, les cannabinoïdes et d’autres substances végétales
Les substances végétales comme la capsaïcine tirée du piment, les substances végétales secondaires neurotoxiques de l’aconit vénéneuse et les cannabinoïdes tirés du chanvre – en particulier le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC), qui détend les muscles et tient la douleur à distance – sont aussi des analgésiques non opioïdes. Les cannabinoïdes se lient à des récepteurs cannabinoïdes spécifiques du système endocannabinoïde (le métamizole sans doute aussi).
Les AINS
Le diclofénac, l’ibuprofène et l’acide acétylsalicylique (Aspirin®) sont également considérés comme des analgésiques. Ce ne sont toutefois pas des analgésiques purs, car leur effet est étroitement lié à leurs propriétés fébrifuges et anti-inflammatoires. On les classe par conséquent dans un groupe à part, celui des antirhumatismaux non stéroïdiens (AINS).
Qu’est-ce que l’échelle analgésique de l’OMS ?
En 1986, l’Organisation mondiale de la Santé a publié une échelle à trois paliers destinée au traitement médicamenteux des cancers. Elle a depuis été élargie à d’autres domaines.
Selon cet instrument, chaque traitement de la douleur devrait commencer par des substances non opioïdes (palier 1). Si leur effet s’avère insuffisant, on passe alors à des opioïdes faibles (palier 2). En cas de besoin, on emploie ensuite des méthodes minimalement invasives et on y associe des opioïdes forts. On combine des opioïdes, des analgésiques non opioïdes et des médicaments adjuvants (des substances qui influencent les douleurs mais n’ont pas été développées à cet effet).

Quels analgésiques créent une dépendance ?
En principe, tous les opioïdes peuvent créer une dépendance, car ils modifient la chimie du cerveau. Leur prise régulière entraîne rapidement une accoutumance : le corps demande de plus en souvent, voire constamment, des doses supplémentaires. On parle alors d’une tolérance au médicament : des quantités toujours plus importantes sont nécessaires pour obtenir le même effet.
Par ailleurs, l’effet euphorisant des opioïdes favorise la dépendance, car il active le système de récompense. La manière dont ces substances sont administrées joue également un rôle dans le risque de dépendance. Plus vite elles pénètrent dans la circulation sanguine, plus vite elles inondent le cerveau, et plus le risque augmente.
Les personnes qui les inhalent ou se les injectent vivent ce qu’on appelle un flash. L’effet est plus lent lorsqu’elles sont prises sous forme de comprimés. D’une part, les comprimés sont enrobés d’une couche qui libère leur contenu progressivement et, d’autre part, la barrière intestinale ralentit leur passage dans le sang.
En raison du risque élevé de dépendance, la prise d’opioïdes sur la durée n’est recommandée qu’à titre exceptionnel. Leurs effets secondaires (fatigue, nausées, vomissement et constipation) ne doivent pas non plus être sous-estimés. Les analgésiques non opioïdes, au contraire, sont associés à un risque faible, voire à aucun risque, de dépendance, à l’exception du cannabis à forte teneur en THC.
Quel analgésique employer ?
Si vous avez de l’arthrose, vous avez peut-être pris l’habitude de prendre un comprimé de paracétamol avant une randonnée ou votre cours de gymnastique hebdomadaire, pour pouvoir bouger sans douleur. En principe, la Ligue suisse contre le rhumatisme appuie la prise préventive d’un analgésique non opioïde à cet effet. Son emploi ciblé peut vous rendre mobile, pour que vous profitiez des bienfaits de l’activité physique. Mais n’oubliez pas que les analgésiques ne rendent pas les articulations affectées plus résistantes ; ils agissent uniquement sur les symptômes, et ils entraînent parfois des effets secondaires.
Faites aussi preuve de prudence lors de l’emploi d’AINS. S’ils sont utiles chez les personnes atteintes de certaines maladies rhumatismales touchant les tissus mous, ils sont déconseillés en cas de maux de dos.1 Demandez conseil à un professionnel ou une professionnelle de la santé si vous prenez fréquemment des analgésiques non opioïdes. Si vous participez à un cours de gymnastique, dites à la personne en charge que vous prenez des analgésiques et que vous vous renseignez sur d’autres soutiens possibles.
En cas de rhumatisme inflammatoire, le traitement médicamenteux vise essentiellement à lutter contre l’inflammation. On ne vous prescrira des analgésiques purs que si vous en avez besoin en plus des anti-inflammatoires. Dans ce cas, on respecte l’échelle analgésique de l’OMS et on emploie des opioïdes à plus long terme uniquement dans des cas exceptionnels.
L’essentiel en bref
- Les opioïdes sont des analgésiques puissants à effet rapide associés à un fort risque de dépendance. Sauf exception, ils doivent être employés à court terme.
- En cas d’arthrose et d’autres maladies rhumatismales non inflammatoires, une préparation de paracétamol en vente libre (ou un autre analgésique non opioïde) peut vous permettre de faire de l’activité physique. Discutez avec un professionnel ou une professionnelle de la santé de cette prise préventive, en fonction de la situation.
- En cas d’arthrose et d’autres maladies rhumatismales inflammatoires, les analgésiques purs jouent un rôle secondaire. Ils complètent un traitement anti-inflammatoire dont l’effet est insuffisant.
Publication : 20 août 2025
Auteur : Patrick Frei, Ligue suisse contre le rhumatisme
Relecture par une experte : Alexandra Litzenburger, physiothérapeute, Msc en physiothérapie de la douleur
Traduction : weiss traductions genossenschaft
Note
- Corp N, Mansell G, Stynes S, Wynne-Jones G, Morsø L, Hill JC, van der Windt DA. Evidence-based treatment recommendations for neck and low back pain across Europe: A systematic review of guidelines. Eur J Pain. 2021 Feb;25(2):275-295. doi: 10.1002/ejp.1679. Epub 2020 Nov 12. PMID: 33064878; PMCID: PMC7839780.
Mots-clés
- AINS
- analgésiques
- antalgiques
- arthrose
- capsaïcine
- dépendance
- endorphines
- foie
- Opioïdes
- THC
- traitement de la douleur