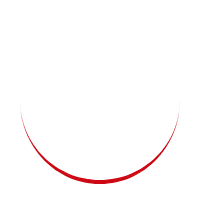Stefanie Briner a 39 ans. Elle a pris soin des autres pendant de nombreuses années, avant de devenir patiente à son tour il y a 8 ans. Le syndrome d’Ehlers-Danlos, une maladie rare du tissu conjonctif, a contraint cette mère de deux enfants à abandonner son travail d’infirmière et à réorganiser son quotidien.
Les malades chroniques savent toujours tout et sont difficiles à prendre en charge. Du moins, c’est ce que pensait Stefanie Briner durant ses 15 années d’activité en tant qu’infirmière. Lorsqu’un syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) lui a été diagnostiqué en 2016, à l’âge de 31 ans, les rôles se sont brusquement inversés.
Les symptômes étaient déjà présents durant l’enfance mais, passionnée d’agrès, Stefanie pensait qu’il s’agissait d’une conséquence normale de ses entraînements. Elle considérait son hypermobilité comme un avantage, et les douleurs à la nuque qui n’avaient jamais disparu après un coup du lapin subi à l’adolescence ne l’inquiétaient pas outre mesure. L’Argovienne ne se souvenait plus de ce qu’était une vie sans douleur, elle acceptait donc ces problèmes qui s’aggravaient pourtant au fil du temps.
Ce n’est qu’à la naissance de son deuxième enfant, lorsqu’elle a soudainement ressenti des douleurs dans les côtes, qu’elle s’est décidée à consulter. En faisant quelques recherches préalables, elle est tombée sur le SED, et elle a réalisé que ce syndrome expliquait tous ses symptômes.
Une énergie insuffisante pour affronter le quotidien
Sa première consultation ne s’est pas du tout déroulée comme celle que vivent généralement les personnes atteintes d’une maladie du tissu conjonctif. Le rhumatologue a pris ses troubles au sérieux dès le départ, l’a soumise à toute une batterie de tests et a fini par confirmer ses soupçons. Son diagnostic : un syndrome d’Ehlers-Danlos de type hypermobile. Les symptômes associés à cette maladie, dont il existe 13 sous-types, sont multiples et varient fortement d’un individu à l’autre. Le diagnostic se fait souvent attendre plusieurs années. Si l’errance diagnostique lui a été épargnée, Stefanie a tout de même dû, elle aussi, apprendre à vivre avec les conséquences du SED.
Elle a jonglé pendant près de deux ans entre sa maladie, sa vie de famille, ses tâches quotidiennes et son travail à l’hôpital. « Je m’épuisais de plus en plus. Je devais me surpasser pour pouvoir continuer à exercer mon métier. J’avais des douleurs extrêmes après mes journées de travail, et j’étais complètement à plat. » En 2018, son médecin a tiré la sonnette d’alarme. Le coeur lourd, elle a démissionné.

« S’apitoyer ensemble »
Son mari et ses deux enfants ont aidé Stefanie à supporter la perte de sa vocation. Sa fille et son fils étaient ravis que leur mère soit à la maison et qu’elle ait du temps pour eux. « J’ai vite remarqué que je perdais beaucoup d’énergie à regretter une situation qui, finalement, ne fonctionnait plus. J’ai décidé d’accepter mon sort et de profiter de ce qui est possible. »
Elle a beaucoup lu sur sa maladie et mieux compris ses ressentis et ses réactions physiques. Les échanges avec d’autres personnes concernées et le fait de « s’apitoyer ensemble », comme elle le dit avec humour, lui ont énormément apporté. Sans ce groupe d’entraide et les personnes qu’elle y a connues, elle n’aurait pas pu autant évoluer.
Se distraire pour ne pas penser à la douleur
Stefanie a certes été diagnostiquée il y a huit ans, mais elle vit depuis toujours avec la maladie. Elle connaît son corps par coeur. Elle sait maintenant que les malades chroniques ont raison : ils·elles en savent davantage que les autres sur leur maladie, parce qu’ils·elles vivent avec au quotidien, parce qu’ils·elles ont tout essayé pour soulager leurs symptômes, et parce qu’ils·elles savent ce qui fonctionne, et ce qui ne fonctionne pas. « La chaleur, les ventouses et les bandages adhésifs sont mes méthodes de prédilection. »
Elle ne pourrait pas non plus se passer des massages de son mari. Chaque semaine, il la masse pendant une heure pour dénouer les indurations. Malheureusement, il n’existe aucun traitement spécifique. Toutes les approches visent uniquement à soulager les symptômes, y compris l’emploi d’analgésiques. Malgré tous les moyens employés, les douleurs ne disparaissent jamais complètement, elles sont aussi là en ce moment, pendant que Stefanie révise des mots d’anglais avec sa fille de neuf ans. Ses enfants font partie intégrante de sa thérapie personnelle : « Lorsque je les aide à faire leurs devoirs, que je fais des bricolages, que j’assemble des Lego ou que je joue à des jeux vidéos, ça me distrait. »
Bouger, c’est bon pour le moral
Stefanie adorerait courir ou faire du trampoline avec ses enfants comme au temps des agrès, mais ce n’est plus possible. Les mouvements intenses ou répétés sur une longue période sont mauvais pour elle, tout comme le fait de rester assise au cinéma ou au théâtre. Elle s’offre parfois quand même une sortie ou une longue promenade mais les douleurs et la fatigue le lui font payer les jours suivants. Elle est malgré tout convaincue que les activités occasionnelles sont bonnes pour sa santé mentale.
Elle bouge bien entendu moins depuis qu’elle a reçu son diagnostic. « J’ai beaucoup de chance que mon mari ait accepté ma maladie dès le début et fasse preuve de beaucoup de compréhension pour ma situation. Lui et les enfants font toujours preuve de considération et me soutiennent autant qu’ils le peuvent. Cela ne va pas de soi. »

Intuition, échanges et connaissances
Stefanie a une multitude de bandages, d’appareils de massage et bandes adhésives à utiliser sur les zones douloureuses, mais rien pour dissiper la fatigue qui l’accable. Tout ce qu’elle peut faire, c’est planifier ses journées et s’accorder un repos suffisant. La physiothérapie lui a parfois même demandé une telle énergie qu’elle ne pouvait plus s’acquitter de ses tâches quotidiennes. Cela dit, elle tient à ses séances hebdomadaires, durant lesquelles elle échange ou « se décharge » au besoin chez sa physiothérapeute.
Elle exprime aussi sa reconnaissance envers la docteure Aylin Canbek (voir p. 24), qui la suit depuis une année : « Avoir une médecin qui comprend, ne juge pas et sait comment interagir avec les malades chroniques est primordial, mais cela ne va malheureusement pas de soi. Elle me donne toujours de récieux conseils et m’informe des dernières découvertes de la recherche. »
Stefanie partage maintenant ses connaissances et offre un conseil par téléphone dans le cadre de ses activités bénévoles au sein de l’organisation de patient·e·s Ehlers-Danlos Netz Schweiz. D’après son expérience, il est essentiel d’écouter son intuition, d’échanger avec les autres et d’en apprendre le plus possible sur la maladie. Aider les autres lui donne de la force au quotidien, et l’idée qu’elle pourrait un jour retrouver son métier d’infirmière lui donne de l’espoir : « Je ne sais pas quand ni comment, mais je travaillerai à nouveau. »
Texte : Simone Fankhauser
Photos : Susanne Seiler