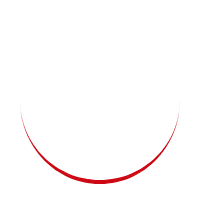Personnelle - réfléchie - sincère ! Voici la nouvelle chronique de la Ligue suisse contre le rhumatisme, écrite par Céline Duss. Conçue à l'origine pour notre magazine pour les membres forumR, Céline Duss écrit sur sa vie en tant que personne atteinte d'un défaut génétique rare, donne un aperçu de son quotidien et nous fait part de ses réflexions. Lisez toujours le dernier article en ligne ici.
Auteur : Céline Duss

Comment respirer librement en étant emprisonnée derrière un masque de protection
Novembre 2025
Les jours se raccourcissent et la légèreté de l’été et de l’automne s’envole. Depuis un certain temps déjà, je redoute l’arrivée des journées d’hiver, car pour moi qui suis atteinte d’une grave immunosuppression, hiver rime avec saison de la grippe et isolement. Je dois éviter par tous les moyens possibles d’être contaminée. Ce qui est une banale infection pour les personnes en bonne santé m’expose à un grand danger, nécessite selon la situation une hospitalisation, un traitement aux soins intensifs et peut avoir une issue fatale au pire des cas.
De plus, en raison de la nature même de ma maladie, chaque petit rhume ou autre infection déclenche une nouvelle poussée, qui m’éprouve et m’affaiblit énormément, détériorant mon état de santé pour plusieurs mois. Selon la gravité, il me faut au moins trois mois pour retrouver l’état de santé que j’avais avant de contracter l’infection ou la maladie. Pour me protéger, je dois porter un masque de protection quand je suis en contact avec les autres et quand je me trouve à l’intérieur de bâtiments. J’applique cette règle durant toute l’année, mais en hiver, il faut redoubler de prudence, dans la mesure où il y a plus de maladies qui circulent. Concrètement, cela signifie que je ne peux rester à l’intérieur d’une pièce avec d’autres personnes sans porter un masque, que je ne peux pas aller manger au restaurant ni fêter Noël avec ma famille. Ces précautions m’excluent de la vie normale. Je suis emprisonnée derrière un masque de protection, avec la peur permanente d’être contaminée, car il n’y a pas de sécurité totale.
L’obscurité et le froid de cette période de l’année ne rendent pas les choses plus faciles. Impossible de rencontrer quelqu’un à l’extérieur en toute insouciance comme lors des soirées chaudes de l’été. En hiver, je me sens isolée, coupée de la vie et parfois aussi, très seule. Les conversations avec les membres de ma famille me manquent, tout comme les échanges personnels avec mes collègues, les rires partagés avec mes amies ou de se prendre dans les bras de temps à autre.
Les personnes ne réagissent pas toutes à la situation de façon compréhensive. Elles estiment parfois que cela n’est peut-être pas si grave ou que j’en fais trop. Parfois, je reçois avec mon masque des regards insistants d’incompréhension. Certaines personnes vont même jusqu’à s’approcher de moi en faisant exprès de tousser fortement. De telles situations me blessent, car je n’ai pas choisi d’être malade et je donnerais tout pour pouvoir mener une vie plus normale. Ces personnes n’ont pas la moindre idée du gros risque auquel je suis exposée de ce fait.
Pour cet hiver, j’ai pris la résolution de ne pas me laisser trop frustrer par l’isolement et de le combattre activement. Je vais exploiter les possibilités qui existent pour participer malgré tout à la vie sociale : appels téléphoniques, entretiens en ligne, promenades à l’extérieur. Puis j’ai aussi des ami·e·s qui montrent beaucoup de compréhension, qui viennent manger avec moi à l’extérieur malgré la neige et les températures frileuses, pour que nous puissions tout de même partager certaines activités.
Je leur suis particulièrement reconnaissante pour leur compréhension et leur prévenance, m’offrant ainsi des îlots de normalité !
Autrefois, une vie sans sport était pour moi inimaginable. L’activité physique faisait partie de mon quotidien, me dépasser me procurait du plaisir. Le sport était un filtre à émotions : aller jusqu’à mes limites physiques me remplissait de satisfaction ; je ressentais tout mon corps, chaque fibre de mon corps. J’ai beaucoup aimé mon corps sportif et performant, ainsi que ma perception différenciée du corps.
Aujourd’hui, je me sens souvent emprisonnée dans mon corps. Mon corps sportif, sculpté, a disparu et l’image de mon corps a beaucoup changé. Je ne peux plus réguler mes émotions avec le sport, le plus important de mes exutoires a subitement disparu. L’envie et le besoin de bouger et de faire du sport ne m’ont pas quittée, mais ma maladie décide désormais de ce que je fais avec mon corps et m’en montre bien clairement les limites. Si je les dépasse, les douleurs se font ressentir. Mes limites prennent de plus en plus de place.
Désormais, je ne peux plus faire que quelques pas chaque jour, en raison de mes os trop cassants. C’est pourquoi je dépends de mon fauteuil roulant électrique. Avec la maladie, il m’a fallu redécouvrir mon corps.
Quand est-ce suffisant, qu’est-ce qui est trop ? La réponse à ces questions ne cesse de varier. Mes limitations physiques diffèrent selon l’intensité de la poussée, des douleurs, des fractures récentes, de la fièvre, des inflammations et selon la stabilité de mes os. Mais je dois toujours me poser cette question, car, en ne faisant rien et en me préservant toujours, mes os deviendraient encore plus cassants et je n’aurais aucune réserve physique lors des poussées.
Je dois avouer que je trouve souvent frustrant de s’entraîner avec une maladie chronique lourde. Je n’arrive pas à atteindre mes objectifs, les petits progrès sont balayés par des poussées régulières, je ne peux compter sur aucun succès ou aucune progression.
Je me fracture régulièrement des os, car le peu d’entraînement était quand même de trop. C’est une stagnation, mais c’est mieux qu’une régression. C’est ce principe qui me pousse à maintenir une activité physique, malgré mes capacités très limitées.
Les quelques mouvements ciblés que je pratique n’ont plus rien à voir avec du sport et avec l’effort que cela nécessite. J’aimerais bien, une fois encore, pouvoir aller jusqu’au bout de mes forces, sentir chaque fibre de mes muscles, être essoufflée. Oui, me sentir... mais le prix à payer serait bien trop fort.
La dépendance aux antalgiques fait la une des médias actuellement. Mais les reportages manquent bien souvent d’impartialité et engendrent une stigmatisation
des personnes faisant usage des opiacés. Hormis la consommation abusive d’antalgiques, certaines personnes sont obligées de prendre des opiacés, j’en fais partie. Sans antalgiques, je ne vais vraiment pas bien. Toutes mes fractures et inflammations articulaires me causent de constantes et fortes douleurs. Et malgré les antalgiques, je ne passe aucun moment sans douleur.
Je ne prends pas des opiacés pour atteindre un état d’euphorie ou un sentiment de bonheur extrême, mais juste pour contrôler en partie les douleurs. Avec eux, le niveau de douleur peut être réduit à environ 6–7 au lieu de 9–10 sur une échelle d’intensité de la douleur. Les opiacés m’aident à gérer mes journées, assurer le quotidien, aller à mes rendezvous, suivre mes traitements, voire même à me lever le matin ou à pouvoir dormir.
La maladie me rend dépendante aux antalgiques. Je définirais la « dépendance » par « ne pas pouvoir se passer d’une chose donnée ». Et oui, sans eux, ça n’irait pas du tout. Les antalgiques m’aident à vivre avec une maladie chronique. Même si être dépendante aux antalgiques est stigmatisant. Combien de fois j’ai dû entendre des commentaires pleins de préjugés tels que « Avec une telle dose, je ne pourrais même plus me lever » ou « vous ne pourrez plus jamais arrêter, vous êtes sûrement dépendante depuis trop longtemps ».
De la pure stigmatisation : comme si je ne préférerais pas vivre sans douleur et sans opiacés ! Or, la stigmatisation arrive très vite, sans pour autant même que l’on me demande comment je gère les antalgiques. Si c’était le cas, je pourrais expliquer que la prise des médicaments est très strictement contrôlée, que je prends très rarement des médicaments supplémentaires et que j’essaie de supporter même de très fortes douleurs pour éviter d’augmenter les doses.
Mon but est d’arriver à ne plus dépendre des antalgiques. Car cela signifierait que je me porterais bien mieux qu’aujourd’hui et que la maladie n’occasionnerait pas de douleurs si fortes. Ces deux choses sont, selon moi, liées. C’est pour cela que j’accepte cette maudite dépendance car je sais que je ne prendrai les antalgiques qu’aussi longtemps que j’aurai besoin de gérer les symptômes de la maladie.
Je souhaiterais que la prise d’opiacés soit considérée différemment et pas systématiquement montrée du doigt. Ce n’est pas parce que certaines personnes en abusent que toutes les personnes doivent être mises dans le même panier et stigmatisées. Sans cette aide, je n’irais vraiment pas bien.
Si je vis avec ma maladie, devrais-je dire « nous » ou bien elle et moi ne faisonsnous qu’un ? Quelle est la meilleure approche ? Je me pose souvent ces questions. Parfois, la réponse est « côte à côte », d’autres fois « ensemble ».
En adoptant le point de vue « ma maladie ET moi », je fais une distinction claire entre ma personne et la maladie. Tout ce qui auparavant, lorsque la maladie n’était pas aussi encombrante, faisait de moi la personne que j’étais, demeure alors inchangé. La maladie devient un élément supplémentaire. Cette façon de voir les choses permet de mettre la maladie de côté plus facilement, même si celle-ci ne disparaît pas et qu’elle occupe de la place. Mais est-ce si facile que cela ? Pas vraiment, si vous voulez mon avis. Pour moi, ce serait plutôt « nous » car la maladie m’influence en tant que personne et inversement, j’influence ma maladie par mes actions, mes convictions et mes comportements.
Malgré tout, j’aimerais bien parfois une distinction plus nette entre les deux : « ma maladie ET moi ». Pouvoir mettre le mot maladie de côté et garder uniquement le « moi ». Mais depuis longtemps maintenant, ce « moi » inclut aussi la maladie car ma maladie chronique ne me laisse aucun répit.
Au fil des ans, j’ai appris que penser « nous » était pour moi la condition pour entretenir un rapport sain à la maladie. J’essaie de trouver des moyens qui me permettent de bien gérer celle-ci ainsi que les conséquences et les contraintes qui vont avec. Car combattre la maladie, et donc mon propre corps, est une dépense d’énergie inutile. Il est bien plus important pour moi de savoir à quel moment je dois absolument écouter la maladie lorsqu’elle se manifeste fortement et s’immisce dans ma vie. Mon écoute s’est affinée avec le temps. J’ai appris à tendre l’oreille plus tôt, à reconnaître les signes silencieux et à accorder, à la maladie tout comme à moimême, l’attention nécessaire. De cette manière, je parviens à identifier rapidement les poussées rhumatismales et peux prendre les mesures nécessaires pour diminuer les douleurs. J’arrive ainsi à vivre sans penser constamment à la maladie. Cela me permet de profiter des moments agréables, de surmonter les difficultés du quotidien et d’écrire mes souvenirs.
Avec les années, j’ai réalisé que « nous » ne signifie pas « être un », que la maladie n’occupe pas entièrement ma vie et que le « moi » ne disparaît pas. Car dans le « nous », il y a aussi « moi » et tout ce qui me caractérise, mes forces et mes faiblesses qui me rendent unique.
Lorsque je quitte la maison, les regards sont braqués sur moi. Je ne passe pas inaperçue avec ma maladie : impossible de dissimuler mon fauteuil roulant électrique, les orthèses et bandages, et puis le masque comme protection contre les infections. Je suis vue et considérée par la société, et le corps médical, comme une personne malade. Personne ne dirait de moi que je suis en bonne santé. Mais c’est ce qu’on pense bien souvent des personnes atteintes de maladies non visibles de l’extérieur, à savoir la majeure partie des personnes malades en Suisse. De l’extérieur, ces personnes ont l’air en bonne santé. Il est facile d’en tirer la conclusion erronée suivante : paraître en bonne santé équivaut à être en bonne santé.
Et pourtant les pathologies invisibles de l’extérieur peuvent être tout aussi lourdes, éprouvantes et pénibles. Ma maladie est un mélange de signes de maladie visibles et non visibles et ce sont en fait les douleurs invisibles et chroniques qui me font le plus souffrir. Un symptôme que personne ne devine de l’extérieur mais qui prend énormément de place dans ma vie. Les personnes atteintes d’une maladie qui ne se voit pas de l’extérieur doivent donc lutter pour être prises au sérieux avec leur maladie. Bien souvent, on leur demande de prouver leur maladie pour être considérées comme malade car qui dit invisible dit inexistant. Un processus très éprouvant et fatigant qui demande énormément d’énergie, car l’ignorance peut faire très mal.
Mais les deux formes de maladies peuvent présenter des avantages. Les maladies invisibles de l’extérieur peuvent être camouflées ou bien dissimulées en société lorsque la situation le demande. Il est alors possible de s’immerger dans le monde des gens en bonne santé. Avec ma maladie visible, je ressens au contraire que je suis prise au sérieux, qu’on me propose de l’aide souvent spontanément et sans trop hésiter, et que l’on fait plus attention à moi. Mais par contre, je suis jugée très vite et on ne me fait pas assez confiance. Les signes apparents de la maladie étant très présents et apparemment limitants, les gens ont tendance à me sousestimer ou à m’oublier en tant que personne.
Cela me demande aussi beaucoup d’énergie de toujours me faire remarquer. Je ne peux jamais cacher ma maladie. Je souhaiterais parfois ne pas paraître différente, ne plus me faire remarquer et ne plus susciter de la pitié, passer inaperçue dans la masse des personnes en bonne santé. Enfin, dans la masse des personnes dont les maladies ne sont pas visibles de l’extérieur et que l’on oublie !
Notre chroniqueuse
Céline Duss – âgée de 30 ans, elle est atteinte d’un défaut génétique très rare qui a chamboulé considérablement son quotidien il y a plus de cinq ans. Le changement de point de vue, de passer de la profession d’experte en soins infirmiers à son statut de personne atteinte d’une maladie chronique, lui ouvre d’autres perspectives. Elle se rend compte au quotidien des obstacles que rencontrent les personnes ayant des limitations. Cela la motive pour s’engager en faveur d’une meilleure inclusion et d’un environnement sans obstacle.